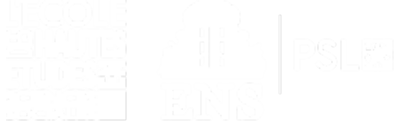Contenu
Maquette et description des UE
Le cursus du parcours Quantifier en sciences sociales (QESS) articule connaissances en sciences sociales (en particulier en sociologie) et compétences en méthodes quantitatives, de la production d’une enquête par questionnaire aux techniques d’analyse statistique avancées. Il fait une place importante à la compréhension des processus de quantification, et à une pratique réflexive et critique des statistiques.
En M1, les étudiants acquièrent ou renforcent un socle de méthodes en sciences sociales et statistiques, qu’ils et elles mettent en pratique à travers un stage collectif en début d’année, la construction d’une enquête par questionnaire et la réalisation d’un mémoire. Ce mémoire les amène à mobiliser toutes les techniques enseignées au cours de l’année. La fin d’année universitaire est libérée pour un stage de découverte professionnelle de 1 à 4 mois.
En M2, les étudiants apprennent des techniques statistiques plus avancées (modélisation, extraction web, statistiques textuelles…), renforcent leurs compétences en sciences sociales et réalisent un mémoire de recherche sur un sujet de leur choix, sous la supervision d’un.e chercheur.e.
Maquettes années précédentes
MASTER 1
UE Séminaire Disciplines – S1 – 24h, 3 ETCS
– Approches anthropologiques – Julien Bonhomme
– Lectures en histoire – André Loez
– Lectures en sociologie – Arnaud Pierrel
proposées au S1 du parcours PDI (1 sur 3, au choix)
UE Sociologie des réseaux sociaux – S1 – 24h, 6 ECTS
Paola Tubaro, chargée de recherche au CNRS
Contact : paola.tubaro[at]ensae.fr
Ce cours propose aux étudiants une introduction à la fois théorique et pratique à l’analyse des réseaux sociaux, et aux théories sociologiques dans lesquelles elle s’inscrit. NB : les « médias sociaux », ou réseaux sociaux électroniques, seront abordés mais ne constituent pas le cœur de ce cours.
Chaque séance inclura des éléments de théorie sociologique, de méthodologie et formation aux logiciels, et des exemples d’application à l’étude de problèmes sociaux concrets à travers la lecture d’articles de sociologie des réseaux.
Ce séminaire est obligatoire dans le cadre du M1 du parcours Quantifier en sciences sociales (QESS). Il est ouvert dans la limite des places disponibles aux étudiant.e.s d’autres masters et aux doctorant.e.s.
Contenus indicatifs. Relations et structures ; réseaux personnels, sociabilité et trajectoires de vie ; les « petits mondes » ; réseaux organisationnels, statut social et pouvoir ; capital social ; influence sociale, diffusion et apprentissage ; homophilie et ségrégation ; réseaux d’internet.
UE Séminaire thématique – 24h, 6 ETCS
A choisir dans la liste de Séminaires conseillés remise en début d’année.
UE Atelier Enquête par questionnaire (Partie 1) – S1 – 28h, 6 ECTS
Damien Cartron, ingénieur de recherche au CNRS (CMH)
et Cécile Brousse, sociologue et statisticienne
Contact : damien.cartron[at]cnrs.fr
Le cours enseigne par la pratique comment construire et administrer une enquête par questionnaire à partir d’un sujet de recherche en sociologie. L’ensemble des étudiant.e.s travaille à la production d’une enquête, sur un sujet défini par les enseignant.e.s.
L’accent sera mis sur le fait qu’une enquête statistique doit être maîtrisée à la fois sur le plan intellectuel et matériel. On soulignera notamment les précautions à prendre pour que les résultats produits puissent s’insérer dans une démarche sociologique.
Le séminaire progresse en trois temps.
1) Revue de littérature, identification des questions de recherche sociologiques et des thèmes à aborder dans le questionnaire. Discussion des ressources et contraintes pesant sur l’enquête (échantillonnage, mode de passation, longueur du questionnaire). Ceci est résumé dans une note d’intention.
2) Les étudiant.e.s rédigent le questionnaire, testent et révisent les questions et les réponses en tenant compte du mode de passation, paramètrent le questionnaire dans le logiciel Limesurvey et effectuent un test final. Rédaction d’un guide de l’enquête.
3) Passation du questionnaire par les étudiants.
Il est recommandé de suivre ce séminaire en M1 pour pouvoir analyser les données l’année suivante, dans le séminaire « Enquête par questionnaire (partie 2) ».
UE Data management : logiciel R – S1 – 36h, 3 ECTS
Abel Aussant, doctorant Sciences Po
Les chercheur.e.s en sciences sociales ont rarement entre les mains des données « prêtes à être modélisées ». Que l’on vise une modélisation basée sur des hypothèses pré-construites ou des analyses plus exploratoires, de multiples opérations préalables sont généralement nécessaires. Ce séminaire se concentre sur ce travail de préparation des données. Outre les méthodes de préparation des données proprement dites, il enseigne comment vérifier chaque étape de son travail et comment le conserver dans des programmes qui puissent être réutilisés.
Les étudiant.e.s apprendront à utiliser R, son interface graphique R Studio et les outils du tidyverse – l’univers des données bien ordonnées dans R Il et elles apprendront comment importer des données, sélectionner des lignes ou des colonnes, transformer la structure d’un jeu de données, recoder des variables qualitatives ou quantitatives, regrouper dans un seul tableau de données des informations provenant de deux tableaux différents, et comment vérifier et corriger leur travail. Enfin il.les apprendront à organiser la succession de ces opérations dans des programmes.
Pré-requis. Pour les étudiant.e.s possédant un ordinateur portable : installer R et RStudio avant le premier cours ; paramétrer Eduroam pour avoir accès à internet. Les étudiant.e.s ne possédant pas d’ordinateur pourront travailler en binôme avec des étudiant.e.s équipé.e.s.
Pour des raisons pédagogiques et logistiques, le séminaire est limité à 20 places.
UE Introduction aux traitements statistiques d’enquêtes sociologiques – S1 – 27h, 3 ETCS
Damien Cartron, ingénieur de recherche au CNRS (CMH)
et Martin Chevalier, administrateur de l’INSEE
Contact : damien.cartron[at]cnrs.fr
Cet enseignement a pour objet de fournir un socle de connaissances théoriques et d’apprentissages empiriques permettant de mener une recherche en statistiques appliquées aux sciences sociales et de développer un sens critique par rapport aux outils employés. Une réflexion sera notamment entreprise sur la représentativité, les principes des sondages et le redressement, afin de de mettre en œuvre des méthodes relativement simples d’analyse des enquêtes sociologiques. Le cours développera par ailleurs les principaux outils de l’analyse statistique univariée et bivariée sur des variables qualitatives et quantitatives.
UE Langue vivante / FLE – 24h, 3 ETCS
Ces cours peuvent être pris indifféremment à l’EHESS, à l’ENS-PSL (ECLA) ou à l’INALCO.
L’offre de cours de l’EHESS est accessible à partir des liens suivants :
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/43/
http://bdl.hypotheses.org/
L’offre de cours de l’ENS est accessible à partir du site de l’Espace des Cultures et Langues d’Ailleurs (ECLA) : www.ens.fr/ecla/
UE Fabrique des données quantitatives – S2 – 16h, 3 ECTS
Etienne Pénissat, chercheur au CNRS et membre du CMH
Contact : etienne.penissat[at]ehess.fr
Quelle est la logique de création de données quantitatives à partir de sources variées (archives historiques, registres administratifs, pages web, etc.) ou d’enquêtes auprès des individus ou des entreprises, à l’échelon national ou international ? Quels outils d’analyse convient-il d’utiliser suivant les différentes disciplines (sociologie, histoire, anthropologie…). Autour de quelques exemples d’analyses statistiques récentes (ISSP, Elfe, refonte des PCS…), les séances entreront dans le cœur de la fabrique des données quantitatives et de leur analyse. Elles dispenseront, en situation, quelques « ficelles du métier », permettant d’enrichir l’imagination des élèves en vue de l’élaboration de leur projet de recherche.
UE analyses factorielles et classifications – S2 – 24h, 6 ECTS
Brianne Dubois, agrégée préparatrice ENS
Contacts : brianne.dubois[at]sciencespo.fr,
Les analyses factorielles ou analyses géométriques de données est souvent utilisée en sciences sociales car elles permettent de décrire un phénomène de comprendre ses différentes dimensions, en mettant en évidence des configurations plutôt que des relations causales. Les classifications, qui permettent d’élaborer des typologies, sont une technique complémentaire des analyses factorielles. Interpréter les résultats de ces techniques, juger de leur robustesse sont des étapes essentielles de l’analyse sociologique.
Le séminaire présente la diversité des usages sociologiques de ces méthodes par l’étude de travaux sociologiques qui les mobilisent, enseigne leur mise en œuvre (avec R et Rstudio), et guide les étudiant.e.s dans l’interprétation des résultats.
Pré-requis. Les étudiant.e.s possédant un ordinateur portable installeront R et RStudio avant le premier cours et paramètreront Eduroam pour avoir accès à internet. Les étudiant.e.s ne possédant pas d’ordinateur pourront travailler en binôme avec des étudiant.e.s équipé.e.s.
Pour des raisons pédagogiques et logistiques, le séminaire est limité à 20 places.
UE Méthodes de régressions multiples – S2 – 24h, 6 ECTS
Jérôme Deauvieau, directeur du département de Sciences sociales de l’ENS
Contact : jerome.deauvieau[at]ens.fr
Ce cours vise à approfondir la maîtrise du raisonnement et des techniques quantitatives dans le domaine des méthodes de régression multiple. Seront abordés la régression linéaire simple et multiple ainsi que la régression logistique dichotomique et polytomique. Le cours sera organisé autour d’introductions historiques et réflexives aux méthodes et à leurs usages en sciences sociales et de mises en pratique sur le logiciel R.
Pré-requis. Ce cours est réservé aux étudiant.e.s ayant déjà reçu une formation aux fondements de la statistique descriptive et de l’utilisation du logiciel R.
Pour des raisons pédagogiques et logistiques, le séminaire est limité à 20 places.
UE Pratique de quantification – stage et mémoire- S1-S2 – 24h, 6 ECTS
Florence Maillochon, directrice de recherche au CNRS, Marie Plessz, chargée de recherche à INRAE et Damien Cartron, ingénieur de recherche au CNRS (CMH)
Contacts : florence.maillochon[at]ens.fr, marie.plessz[at]inrae.fr, damien.cartron[at]cnrs.fr
Cette UE permet aux étudiants de mobiliser les compétences qu’ils acquièrent en M1 autour d’un mémoire de recherche personnel, formulant une question de recherche sociologique et mettant en œuvre une démarche d’analyse quantitative. Elle repose sur deux dispositifs pédagogiques :
- Stages collectifs
- Une semaine à la rentrée, centrée sur l’analyse secondaire d’enquêtes quantitatives (déjà constituées)
- Un stage hors les murs en observation participante sur une collecte de données d’enquête portée par une institution (exemple : recensement des sans-abris à Paris par le Samusocial et la ville de Paris, enquête nationale sur la vie affective des jeunes (Envie), par l’Ined).
- Le mémoire de M1 : ce mémoire mobilise des données présentées pendant le stage d rentrée et toutes les compétences sociologiques et statistiques acquises au cours de l’année. Un atelier accompagne la préparation des mémoires tout au long de l’année. Une journée de soutenance clôt l’année universitaire fin juin (suivi d’une petite fête).
UE Outils pour la recherche – S2 – 18h, 3 ECTS
Cécile Brousse, sociologue et statisticienne
Ce séminaire fournit aux étudiants des outils et des conseils concrets pour en vue de la préparation d’un projet de mémoire ou d’un mémoire de recherche mobilisant des méthodes quantitatives. Il privilégie les logiciels libres.
Le contenu du mémoire de M1 est présenté pendant le stage pédagogique de rentrée au sein du parcours Quantifier en sciences sociales.
– Organiser une recherche documentaire : la bibliothèque de Jourdan et Zotero (en bibliothèque)
– Faire une revue de littérature
– Utiliser Limesurvey pour la réalisation d’enquêtes en ligne
– Trouver des données d’enquête existantes : ADISP
– Protéger les données d’enquête
– Structurer, rédiger et mettre en page un mémoire avec LibreOffice
– Suivi des projets de mémoire
– Exporter tableaux et graphiques depuis R
Pour des raisons pédagogiques et logistiques, le séminaire est limité à 20 places.
MASTER 2
UE Modélisation avancée en sciences sociales, 24h, 6 ECTS
Marie Plessz, DR INRAE et Professeur attachée ENS-PSL
Raphaël Dhuot, Chercheur CNAV
Ce cours forme à la modélisation quantitative pour répondre à des questions de recherche en sciences sociales. Il s’adresse à des étudiant·es ayant déjà une familiarité avec les régressions linéaires et logistiques et avec le logiciel R (charger des données, recoder des variables et réaliser un modèle de régression).
La modélisation a pour but de spécifier des modèles statistiques qui permettent de résoudre des questions de recherche complexes tout en étant adaptés aux données, afin d’obtenir des résultats robustes. Le cours explorera la modélisation et ses usages en sciences sociales, en particulier en sociologie quantitative, en alternant lecture de textes, cours et cas pratiques.
En particulier deux situations de modélisation seront examinées :
- Modéliser pour analyser des données longitudinales, ou répétées
- Modéliser pour s’approcher d’un raisonnement causal.
On examinera tant les aspects pratiques de ces stratégies que leurs hypothèses, leurs forces et leurs limites, et on discutera d’éventuelles alternatives.
UE Webscraping et analyse textuelle – S3 – 30h, 6 ECTS
Partie 1 – Webscraping
Julia Descamps, Doctorante INED
Partie 2 – Analyse textuelle
Bénédicte Garnier, ingénieure au service méthodes statistiques (SMS) de l’Institut national d’études démographiques (INED)
Contact : garnier[at]ined.fr
La première partie du cours, consiste en une découverte des méthodes d’extraction de données disponibles en ligne. À partir d’un cas pratique, les étudiantes et les étudiants apprendront à mettre en place un protocole afin d’extraire et traiter des données présentes sur des sites internet ou des réseaux sociaux. Le logiciel R est utilisé afin d’aspirer les données et de les stocker sous forme de base de données.
La seconde partie permet de maitriser les méthodes de statistique textuelle pour analyser des corpus de types différents (questions ouvertes, entretiens, articles , etc..). La mise en pratique se fait avec R (notamment le paquet R.temis) pour transformer les données textuelles en tableaux lexicaux et pouvoir ensuite appliquer ces méthodes. Les éléments abordés en cours, ainsi que la lectures d’articles traitant ces données dites « non structurées », permettront de savoir interpréter les résultats et les restituer à un public non averti.
UE Stage de cartographie – S3 24h, 6 ECTS
Romain Leconte, chargé d’enseignement au département Géographie de l’ENS-PSL
Ce stage correspond à l’enseignement « Méthodes quantitatives avancées avec R: analyse spatiale » proposé par le Département de Géographie de l’ENS.
L’objectif de l’enseignement est d’introduire de manière explicite et formalisée la dimension spatiale dans l’analyse des faits sociaux. S’appuyant sur la formulation de la première loi de la géographie par Waldo Tobler en 1970, « Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things« , l’analyse spatiale fait de la distance (dans ses multiples formes: proximités, espacement, réseaux, frontières…)la clé de compréhension des structures sociales dans l’espace.
En premier lieu, cela passe par l’analyse des distributions spatiales avec l’acquisition des méthodes de la cartographie. Techniquement, il s’agit de savoir manipuler dans R les objets spatiaux avec _sf_ (géométries, coordonnées géographiques, systèmes de projection). Mais cela pose également des questions plus fondamentales: quel impact de l’échelle et des mailles d’observation sur les résultats obtenus ? Les formes observées (concentration, dispersion) sont-elles significatives ou aléatoires ? Quel est le type de distance qui permet d’expliquer au mieux ces formes ? Il s’agit donc, dans un second temps, de modéliser ces distributions en prenant en compte explicitement les localisations relatives (par ex. autocorrélation spatiale, régression pondérée géographiquement -GWR- etc.). Cette année, le stage portera sur l’analyse spatiale des inégalités économiques dans les métropoles françaises.
Graphiques et langages visuels pour les sciences sociales
Donato Ricci, chargé de recherche, Medialab, Sciences Po
a pratique de la visualisation de données est de plus en plus facile et accessible, grâce à des logiciels dédiés (par exemple tableau ou datawrapper) et dse bibliothèques ouvertes (par exemple d3.js ou ggplot2). Le but de ce séminaire et d’introduire la composante théorique et réflexive nécessaire à la réalisation d’une visualisation « lisible », composante qui est souvent sous-estimée.
Le cours, en inscrivant les activités de visualisation de données dans la grande famille des langages visuels, présentera les fondements théoriques de la visualisation dans la discipline, en se concentrant notamment sur la sémiotique de la communication visuelle et la théorie de la gestalt.
À travers une série d’exercices de lecture et décodage de petites études de cas qui ont marqué l’histoire de la discipline, le cours se concentrera sur la description de la mise en œuvre de ces principes. L’expérience produite par cette série d’exercices sera ensuite utilisée comme base pour tester, améliorer et transformer les visualisations déjà produites par les étudiants dans leurs autres projets.
Les étudiant·es devront apporter un dossier sur lequel travailler pendant le cours, incluant une visualisation en cours de création et les matériaux associés (données, fiches méthodologiques, textes interprétatifs…).
UE Module de professionnalisation – S3 – 18h, 3 ECTS
– Cycle Auteurs
– Readings in the Social Sciences, en anglais
– Interdisciplinarité en action
proposés au S3 du parcours PDI
(1 sur 3, au choix)
– Après le master (Non noté)
UE Atelier de recherche – S3 – 24h, 9 ECTS
– Enquête par questionnaire (Partie 2)
– Atelier de recherche du parcours PDI
à choisir dans la liste d’Ateliers conseillés sur le site du master.
UE Séminaire thématique – S4 – 24h, 6 ETCS
à choisir dans la liste de Séminaires conseillés remise en début d’année.
UE Atelier Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche – 24 ECTS
Suivi collectif de l’avancement des mémoires de recherche de M2