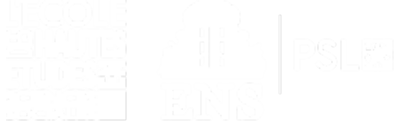Contenu
La mesure du mérite : enquêter sur les instruments et les pratiques de sélection des étudiant·es
S1-S2–24h, 9 ECTS
Pablo Cussac et Aliénor Balaudé-André
Mardi 14h30-16h : 26/09 – 10 et 24/10 – 07 et 21/11 – 05/12 – 23/01 – 06/02.
Mardi 15h-18h : 20/02 – 13/03 – 10/04 – 08/05
Précision : entre septembre et mars, les séances dureront 1h30; à partir de mars, les séances seront de 3h.
Salle R3-46 à Jourdan
Pour plus d’informations:
Les égoûts de L’viv. Atelier d’enquête
S2 – 24h, 9 ECTS
Thomas Chopard (thomas.chopard@ehess.fr), Judith Lyon-Caen (jlc@ehess.fr), Claire Zalc (claire.zalc@ehess.fr)
De juin 1943 à la fin de juillet 1944, un groupe de dix juifs a survécu à la Shoah en se cachant dans les égouts de L’viv (Lwów) avec l’aide de trois égoutiers polonais, non juifs. Cette extraordinaire histoire de survie est rapidement devenue célèbre : plusieurs survivants ont témoigné, à plusieurs reprises, dans des cadres et sur des supports variés. Un journaliste et écrivain australien, Robert Marshall, a fait de cette « histoire héroïque » la matière d’un livre haletant mêlant récit, entretiens et documents (In the sewers of Lwow, 1991) ; la réalisatrice Agnieszka Holland en a fait un film à succès (In Darkness, 2012). En 2021, une équipe de chercheurs et d’« explorateurs urbains » ukrainiens a retrouvé la cachette principale et établit le chemin parcouru sous terre par le groupe. En 2022, l’historienne, architecte et artiste Natalia Romik a consacré une exposition aux « architectures de la survie » à la galerie d’art contemporain Zacheta de Varsovie…
Parmi les survivants se trouvait Jacob Berestycki, le père d’Henri Berestycki, mathématicien, directeur d’études à l’EHESS.
L’atelier se propose de conduire une enquête inédite autour de cette histoire de cachette, de survie et de transmission, en compagnie d’Henri Berestycki. À distance de toute approche anecdotique, on articulera une recherche d’histoire sociale de la clandestinité et de la survie (qui étaient les soixante-dix, puis les 21, puis les 10 – ou 11 – qui se sont cachés et ont survécu ?), une analyse fine de leurs parcours avant et après la guerre et de leurs relations avec leurs sauveteurs, et une étude des mises en mémoire et en récit, stratifiées et parfois concurrentes, à laquelle « les égoûts de L’viv » ont donné lieu. Cet atelier de recherche vise à former les étudiants à la recherche par la recherche, en collectant et explorant ensemble une diversité de sources historiques et de matériaux ethnographiques, littéraires, artistiques : l’enquête collective sera l’occasion de s’approprier les outils de la micro-histoire de la Shoah, d’explorer les archives disponibles sur la vie et la mort dans le ghetto de Lwów (1941-1944), de réfléchir aux liens entre histoire sociale et histoire familiale, aux relations entre survie et récit, ainsi qu’aux conditions sociales et politiques du témoignage et de la mémoire, à l’historicité des formes narratives qui prennent en charge la transmission de la Shoah depuis la fin de la guerre.
Il aura lieu au 54 bd Raspail
Salle AS1_23
2nd semestre / bimensuel (1re/3e), jeudi 16:00-19:00
du 15 février 2024 au 20 juin 2024
Nombre de séances : 8
Sociologie politique des changements électoraux. Une enquête collective sur la séquence électorale du printemps 2024
Pierre Blavier (CNRS, Clersé) & Anton Perdoncin (CNRS, Cens)
2024-2025 — Master Sciences Sociales (Parcours PDI et QESS), EHESS, ENS
La séquence politique ouverte par les élections européennes de juin 2024 et la dissolution de l’Assemblée nationale a manifesté la collision de tendances lourdes (progression du vote FN/RN, stabilisation à un niveau bas de l’adhésion électorale aux partis historiques de la social-démocratie et de la droite dite “républicaine”) et de revirements inattendus (forte participation électorale caractéristique des élections “à enjeu”, victoire relative d’un bloc de gauche reconstitué). Les résultats électoraux tendent à l’analyse sociologique et politique
un miroir déformant, au moins à trois titres : d’abord car la pratique électorale – même lorsque près de 70% du corps électoral s’est déplacé au bureau de vote – demeure fortement sélective (malinscription, abstention), ensuite car les choix exprimés dans les urnes dépendent essentiellement de combinaisons d’appareils et de programmes dont les logiques sont souvent fort éloignées des cultures et pratiques politiques concrètes des citoyen.nes, enfin car les résultats dépendent du mode de scrutin et des logiques éventuelles de désistement ou de maintien, masquant a posteriori des différences parfois petites entre les candidats élus et leurs rivaux. Le vote et les préférences électorales demeurent pourtant de puissants analyseurs des rapports politiques au sein d’une société. Comment comprendre cette nouvelle donne électorale ? Quels sont les électeurs qui se sont mobilisés ? Cette mobilisation électorale constitue-t-elle un réservoir de votes pour l’extrême-droite ?
L’atelier est ouvert à tou.tes les étudiant.es du master de Sciences sociales (EHESS, ENS), parcours PDI et QESS. Aucun prérequis en méthodes quantitatives ni en maîtrise logicielle n’est demandé. . . si ce n’est le souhait d’apprendre à mettre en œuvre des techniques de description et de modélisation statistique des phénomènes sociaux.
Pour une présentation complète de l’atelier, des méthodes, du calendrier des séances et des modes de validation, télécharger le document di-dessous:
Lieu : Campus Jourdan (salle à confirmer)
Horaires : vendredi de 13h30 à 16h30.
Du 22/11/24 au 11/04/2025 (8 séances)
L’assiduité à l’ensemble des séances est requise, ainsi que la contribution aux différents travaux collectifs, et la réalisation en binôme ou trinôme d’un mini-mémoire.
Sortir les syndicats pénitentiaires de l’ombre. Pour une sociologie des relations professionnelles du champ carcéral
Nathan Rivet (nathan.rivet@ens.psl.eu) et Corentin Durand (corentin.durand@ehess.fr)
Semestre 1 & 2 – Vendredi après-midi
Janvier 2018. Suite à l’agression d’un surveillant par un détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, une intersyndicale composée des principales organisations représentatives de l’administration pénitentiaire appelle au blocage de prisons sur tout le territoire. Les images de surveillants refusant de reprendre le travail et brûlant des tas de palettes et de pneus à l’entrée de plusieurs établissements font le tour des médias. Après plusieurs semaines de manifestations et de négociations, le mouvement cesse et le syndicat majoritaire signe un accord avec le ministère de la Justice.
Forte participation aux élections professionnelles, nombreux élus dans diverses instances, communication numérique et médiatique saillante, les syndicats pénitentiaires occupent une place importante dans le paysage carcéral français. Pourtant, contrairement à d’autres dimensions du monde pénitentiaire étudiées par les chercheur-ses en sciences sociales, les syndicats en demeurent un aspect méconnu, quand bien-même ils en sont une partie très visible. Actifs au sein des prisons comme en administration centrale et liés -mais pas que- à de grandes centrales syndicales (FO, UNSA, CGT…), les syndicats des personnels pénitentiaires sont devenus un rouage de l’action publique pénitentiaire, au même titre que les syndicats d’autres forces de l’ordre. Cet atelier a pour objectif d’enquêter collectivement sur les multiples dimensions des syndicats pénitentiaires, allant de leur activité à leurs revendications et leurs modes d’action en passant par leurs évolutions, leur rôle politique ainsi que leurs différences intersectorielles ou internationales. Les étudiant-es choisiront, en lien étroit avec les encadrants du cours, leur question de recherche. L’atelier formera les participant-es aux différentes étapes de l’enquête : trouver son objet d’étude, construire son protocole, faire des aller-retours entre empirie et théorie, analyser ses matériaux, écrire d’un rapport de recherche, restituer et discuter en format séminaire.
L’évaluation comprendra plusieurs notes. L’atelier repose sur la participation active des participant-es. Au fil du semestre, une série de courts rendus ou, parfois, de présentations de la recherche en train de se faire, viendra évaluer l’investissement des étudiant-es. L’ensemble de ces étapes conduira, par étapes, à l’écriture d’un rapport de recherche qui constituera la majeure partie de la note finale.
L’atelier est ouvert à tous les étudiant-es de l’ENS et de l’EHESS. Pour pouvoir mener l’enquête collective dans les meilleures conditions, l’atelier est limité à 12 places et nécessite une inscription préalable. Les étudiant-es souhaitant s’inscrire à l’atelier doivent prendre contact avec l’enseignant (nathan.rivet@ens.psl.eu). Une expérience préalable d’enquête en sciences sociales n’est pas nécessaire, mais recommandée.
Dates et heures : 6/10 : 14h-15h30 ; 20/10 : 14h-16h ; 10/11 : 14h-16h ; 24/11 : 14-16h ; 8/12 : 14-15h30 ; 26/01 : 14h-17h ; 16/02 : 14h-17h ; 15/03 : 14h-17h ; 05/04 : 14h-17h ; 10/05 : 14h-17h.
Vivre au contact des risques industriels et nucléaires
S1 et S2 – 24h, 9 ECTS
Alexis Spire (alexis.spire@gmail.com)
Atelier ouvert aux étudiant.es de M1 et de M2.
L’objectif de cet atelier est de conduire une enquête collective sur la perception des risques industriels et nucléaires par les habitant.es qui résident dans ces zones. Le terrain choisi est celui du littoral dunkerquois qui regroupe une vingtaine de sites classés dangereux à très dangereux du point de vue des accidents industriels auxquels s’ajoute la présence de la plus grande centrale d’Europe (six réacteurs). En 2023, une enquête collective a été réalisée avec des étudiants du master à Gravelines.
Pour cette deuxième année, l’atelier consistera à nouveau dans la préparation et la réalisation d’une enquête collective dans une autre ville du littoral dunkerquois.
Cet atelier s’inscrit dans le programme de recherche intitulé « Monde d’Avant Monde d’Après » (MAMA) financé par le CNRS.
L’atelier aura lieu le mardi de 9h à 11h aux dates suivantes : 7 novembre, 28 novembre, 19 décembre, 16 janvier, 13 février.
La semaine de terrain aura lieu du 11 au 15 mars 2024.
Nombre de participants limité à 10.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail concernant votre intention de participer à cet atelier à alexis.spire@gmail.com
Enquêter les classes sociales en Europe
Etienne Penissat (etienne.penissat@cnrs.fr), Marton Angyan (marton.angyan@ehess.fr), Anouck Manez (anouck.manez@ehess.fr), Margot Roisin-Jonquières (margot.roisin@ehess.fr) et Martina Vignoli (Martina.Vignoli@uphf.fr)
Si le processus de formation des classes sociales s’est organisé dans le cadre de la construction des États-nations, en particulier des Welfare States, il a toujours été travaillé par les migrations et par les relations à distances (concurrence, solidarité, etc.) entre classes sociales nationales. La construction d’espaces politiques et économiques globalisés, à l’image de l’Union Européenne, et l’accroissement des migrations pose de façon plus intense la question de la projection des rapports de classe dans des espaces sociaux internationaux voire transnationaux. Qu’est-ce que la configuration de ce type d’espace fait aux rapports de classe ? Dans quelle mesure les circulations de travailleur·ses, de retraité·es, d’étudiant·es et de touristes intra et extra-européen·ne·s transforment voire recomposent les rapports de classe ? Assiste-t-on à la formation de classes sociales transnationales ?
Le séminaire développe trois axes de réflexion. D’abord, il aborde les méthodes et les concepts permettant de comparer les positions de classe et les processus de convergences-divergences entre groupes sociaux à l’échelle européenne. Ensuite, il questionne ce que les rencontres et les confrontations qui se nouent entre habitant·es de l’Europe par les migrations (professionnelles, touristiques, scolaires, etc.), font aux rapports de classe. Nous prêtons une attention particulière à l’articulation de ces derniers avec des rapports de genre, de nationalité, de race. Enfin, il interroge les effets asymétriques (ou non) de ces mobilités entre les classes sociales et sur la manière dont elles participent (ou non) à la reproduction des rapports de classe.
En 2023-2024, nous avons déployé plusieurs de ces questionnements dans le cadre d’une enquête collective auprès des employé·es de la restauration dédiée à une clientèle aisée (appartenant principalement aux classes dominantes) et majoritairement étrangère. Menée par l’ensemble des participant·es (encadrant·es et étudiant·es), l’enquête s’est déroulée dans les quartiers « bourgeois » (le « triangle d’or ») et « touristiques » (quartier « latin » par exemple) de Paris et consiste à mener des observations ponctuelles et des entretiens biographiques avec ces employé·es. Outre l’analyse des positions de classe et des conditions de travail, l’enquête permet de travailler les relations qui se nouent entre employé·es et client·es sous l’angle des relations de service et des rapports de classe, les formes de capitaux internationaux qu’acquièrent et développent ces employé·es ainsi que les formes de classements et reclassements sociaux que ces rapports de classe internationalisés impliquent pour eux et elles.
En 2024-2025, il s’agira de poursuivre ces questionnements et de prolonger l’enquête collective dans la restauration de luxe à Paris mais aussi dans d’autres villes en France ou à l’étranger. De ce fait, de nouveaux étudiant·es et doctorant·es sont les bienvenus et pourront s’intégrer à l’enquête initiée cette année.
L’atelier se déroule au 48 bd Jourdan, 75014 Paris. Les vendredis après-midi à partir du 11 octobre.
Contact par courriel : etienne.penissat@cnrs.fr
Crédits ECTS: 9
Enquête par questionnaire : la répartition des tâches domestiques au sein de la famille
Abel Aussant (Cour des comptes-CRIS-CREST), abel.aussant@sciencespo.fr
Cécile Brousse (ENS-INSEE), cecile.brousse@insee.fr
Mettre en place une enquête par questionnaire est de plus en plus facile grâce aux dispositifs d’enquête en ligne, mais que faire des données une fois qu’elles ont été collectées ? Les principes de la science ouverte nous encouragent à rendre nos données accessibles aux autres (dans le respect de la protection des données personnelles), mais des données peu ou mal documentées sont en réalité inexploitables par les autres (ou par nous dans dix ans).
Cet atelier sera consacré aux étapes qui permettent de transformer un tableau de données en une enquête statistique documentée et exploitable, et d’en tirer de premiers résultats sociologiques. Ces étapes permettent aussi de réfléchir à la qualité des données ainsi collectées : quelles questions s’avèrent décevantes ou intéressantes ? a-t-on oublié des informations importantes ?
Au cours de l’atelier, les étudiants travailleront sur l’enquête statistique collectée l’année précédente dans le cadre de l’atelier Enquête quantitative (Partie 1), avec le logiciel R, pour livrer un rapport d’enquête complet (données, documentation des données, premières exploitation).
Principales compétences développées :
- Nettoyer des données
- Documenter des données
- Réaliser les premières analyses
- Discuter la qualité des données
- Effectuer toutes ces opérations en pensant aux personnes qui pourraient exploiter ces données dans le futur (y compris nous-mêmes).
Exploitation des données recueillies l’an dernier dans l’atelier Enquête par questionnaire Partie 1 : nettoyage et documentation des données, premières analyses. Thématique de l’enquête pour 2023-2024 : la répartition des tâches domestiques au sein de la famille.
Enquêter sur la mise en gouvernement de l’environnement – France, 1969-1977
Christophe Bonneuil (CNRS, Centre de Recherches Historiques) et Arthur Delacquis (SIRICE, Sorbonne Université)
Croisant socio-histoire de l’État et histoire environnementale, cet atelier propose de revisiter la genèse et les premières années de la création du Ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement (1971), à travers l’étude d’archives. Pourquoi créer un Ministère pour gérer sectoriellement un nouveau champ de politique publique ? Comment « l’environnement » est-il institutionnalisé et construit comme objet de gouvernement ? Quels sont les éléments de contexte internationaux favorables à la mise sur agenda de « l’environnement » (dont Conférence ONU de Stockholm en 1972) et comment le gouvernement français y répond ? Comment s’organise le travail gouvernemental et que fait un ministre ? Comment se négocie la dimension interministérielle de la politique de l’environnement ? Quels défis au pouvoir étatique et au patronat industriel sont posés par l’émergence d’une critique de la croissance, ainsi que d’alertes et de mobilisations écologistes, en cette fin des dites « Trente Glorieuses » ? Comment se déploie l’action gouvernementale pour y répondre et gouverner les alertes et critiques écologiques (discours, institutions, formes d’expertise et types d’instruments d’action) ?
Pour investiguer empiriquement ce que mettre en gouvernement l’environnement signifie, l’atelier reposera principalement sur l’exploitation de première main de différents fonds d’archives (fonds du Ministère de l’environnement, de l’Élysée, de Matignon ; fonds de la DATAR et de Serge Antoine, voire si besoin, archives patronales, préfectorales ou associatives) autour de quelques cas d’étude précis.
Après une journée de visite des Archives et découverte de premiers documents (AN Pierrefitte) et quelques séances introductives, les étudiant.es s’organiseront en binômes qui choisiront – en lien avec l’encadrant et le groupe – leur terrain et leur question de recherche. L’atelier formera les participant-es aux différentes étapes de l’enquête : construire son objet d’étude et ses questions en synergie avec les recherches des autres binômes, construire son enquête, tisser des aller-retours entre trouvailles d’archives et historiographie, analyser et critiquer ses sources, construire un récit (article) et le partager (format séminaire).
La présence à la première journée aux archives (prévue le 30 oct.) et l’assiduité à l’ensemble des séances est requise, ainsi qu’un travail personnel de recherche en binômes et une contribution constructive à l’avancée des autres binômes par la discussion de leurs travaux. L’évaluation portera pour 1/3 sur la participation active des participant-es au collectif de recherche (rendus ou présentations de l’état d’avancement des binômes et leur discussion collective) et pour 2/3 sur rapport de recherche de format article (complété d’annexes) qui pourrait être soumis à une revue. L’atelier est ouvert à tous les étudiant.es de de l’EHESS et de l’ENS. Pour pouvoir mener l’enquête collective dans les meilleures conditions, l’atelier est limité à 12 places et nécessite une inscription préalable. Les étudiant-es souhaitant s’inscrire à l’atelier doivent prendre contact avec l’enseignant (christophe.bonneuil@cnrs.fr) avant mi octobre. Une expérience préalable d’enquête en archives historiques n’est pas nécessaire, mais un bagage en sciences sociales est recommandé.
Les mercredi de 11h30 à 13h30 à l’ENS.